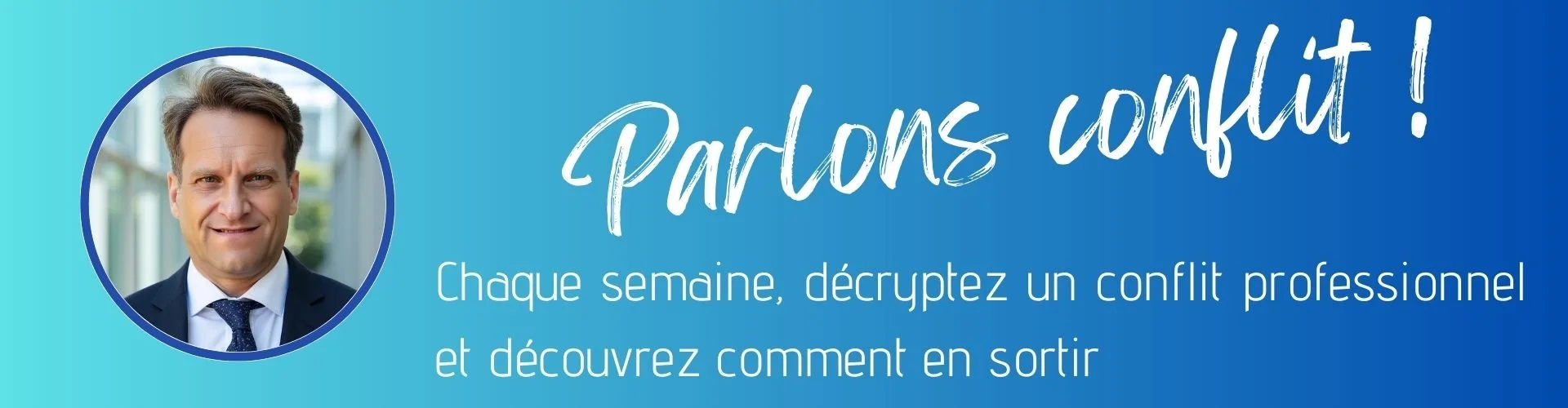Un conflit au cœur d’un partenariat
5 octobre 2025 | Écrit par Sébastien Robineau | Temps de lecture : 10 minutes
Sommaire
Un conflit, une médiation
Le frein à la médiation : le coût de la médiation
Le déroulement de la médiation : de l’individuel au collectif
L’outil utilisé dans cette médiation : l’appreciative inquiry
Les enseignement de cette médiation
Conclusion
Un conflit, une médiation
A l’automne 2021, une société française de design digital et une entreprise belge spécialisée dans le développement logiciel ont décidé d’unir leurs forces. Leur ambition était de lancer une plateforme innovante permettant aux commerçants de créer facilement leurs boutiques en ligne, avec une interface soignée et des outils techniques robustes. Le développement du « click & collect » lors du premier confinement avait montré la faible digitalisation des PME et TPE de France comme de Belgique.
Le partenariat reposait sur un contrat signé à Bruxelles, après plusieurs mois de négociations. Élodie, fondatrice de la société française, et Marc, dirigeant de la société belge, étaient convaincus d’avoir trouvé la combinaison gagnante : le design créatif d’un côté, la solidité technique de l’autre.
Mais derrière l’enthousiasme, un détail allait tout compliquer : une clause contractuelle ambiguë sur la répartition des bénéfices.
Le frein à la médiation : le coût de la médiation
Le contrat stipulait :
« Les revenus nets seront partagés équitablement entre les parties, proportionnellement à leurs investissements respectifs. »
Pour Marc, cette formulation signifiait un calcul précis au prorata des dépenses engagées. Ses développeurs travaillaient d’arrache-pied, il investissait en serveurs et en licences coûteuses. Il estimait donc que son entreprise devait recevoir une part majoritaire des bénéfices.
Élodie avait une lecture tout autre. Pour elle, « équitablement » voulait dire 50/50. Les risques avaient été pris ensemble, et son équipe avait consacré des centaines d’heures de création non facturées pour donner vie à la plateforme. Comment mesurer la valeur d’une expérience utilisateur impeccable ?
Très vite, le désaccord a envenimé les relations. Marc accusait Élodie de « mépriser les coûts réels ». Élodie reprochait à Marc de « réduire la créativité à zéro euro ».
Nous étions face à un conflit institutionnel typique : une règle contractuelle ambiguë, interprétée de manière divergente.
Un ami commun leur a suggéré une médiation. Élodie a accepté immédiatement. Mais Marc a refusé.
Son frein ? La crainte d’un processus trop long.
« On n’a pas de temps à perdre. Dans trois mois, nous serons présents au Paris Retail Week. Si on s’enlise dans des réunions interminables, on ratera la fenêtre de tir. ».
Cette inquiétude est fréquente. Beaucoup d’entrepreneurs redoutent que la médiation ne soit un luxe chronophage. En réalité, elle est souvent bien plus rapide qu’une procédure judiciaire.
Je l’ai expliqué à Marc :
une médiation peut être menée en deux ou trois séances de quelques heures,
elle permet d’aboutir à un accord partiel qui sécurise le projet, même si tout n’est pas réglé,
elle évite la paralysie totale.
Peu à peu, convaincu par la flexibilité du processus, Marc a accepté de tenter l’expérience.
Le déroulement de la médiation : de l’individuel au collectif
Lors de notre premier échange, Élodie est arrivée avec un carnet rempli de croquis et de notes. Elle m’a dit :
« Sans nous, la plateforme n’existerait pas. L’interface, le design, l’expérience utilisateur, c’est ça qui fait vendre. Si on fait du moche, personne ne s’inscrira. Mais Marc agit comme si mon travail ne comptait pas. ».
En creusant, son besoin est apparu clairement : la reconnaissance de la valeur du travail de créativité et d’innovation déployé par son équipe.
Marc, de son côté, avait un dossier de factures.
« Je paye 15 développeurs à temps plein, des serveurs cloud hors de prix, des licences logicielles. Tout ça, c’est concret. Ce n’est pas des idées, ce sont des coûts. Je ne peux pas accepter d’être mis à égalité alors que j’investis trois fois plus. »
Son besoin essentiel était la reconnaissance des coûts financiers réels et supportés par l’entreprise belge.
La première séance commune a commencé dans une ambiance glaciale. Marc a exposé ses calculs, démontrant que son entreprise investissait davantage. Élodie a répliqué en rappelant que l’UX était un atout stratégique.
Très vite, la discussion a tourné en rond. Chacun répétait ses arguments, incapable d’entendre l’autre.
L’outil utilisé dans cette médiation : l’appreciative inquiry
C’est à ce moment que j’ai décidé de changer de braquet. Ils avaient besoin de s’invectiver. C’était fait. Plutôt que de se battre sur la clause, je les ai fait travailler sur ce qui avait bien fonctionné, fidèle à l’approche de l’Appreciative Inquiry (AI). Et j’ai déroulé mes questions en 4 temps :
J’ai posé la question suivante, illustrant à l’étape Discovery de l’AI :
« Qu’est-ce qui vous a donné envie de signer ce partenariat ? »
Élodie a répondu très spontanément : « J’ai aimé la vision de Marc. On partageait l’envie d’aider les petites entreprises à se digitaliser. ».
Marc a précisé « J’ai été impressionné par la créativité de l’équipe d’Elodie. J’ai vu qu’ensemble, on pouvait proposer une offre unique. ».
Dès cette étape, un point commun a émergé : la fierté initiale du projet.
Puis, je leur ai demandé d’imaginer « comment serait votre partenariat idéal dans trois ans ? » (étape Dream de l’AI)
Élodie voit leur partenariat comme « un projet présenté comme une réussite franco-belge, où chacun est reconnu à égalité. ».
Marc, quant à lui, s’est projeté dans une « plateforme qui cartonne en Europe, avec des clients satisfaits et une équipe fière. ».
Leur rêve n’était pas incompatible.
Dans le respect de l’étape Design de l’AI, nous avons ensuite travaillé sur des solutions concrètes. Plusieurs idées ont émergé :
définir une grille de valorisation du design (nombre d’heures, livrables, prototypes),
inclure dans le calcul à la fois les coûts financiers et les apports immatériels,
prévoir une clause de révision annuelle pour ajuster la répartition si les investissements évoluent.
Il ne restait plus qu’à mettre en œuvre tout ça (ce que l’on aborde toujours dans l’étape Destiny de l’AI).
Ils ont trouvé un compromis :
40 % des revenus répartis au prorata des coûts réels,
60 % répartis à parts égales, pour refléter le risque partagé et la complémentarité des expertises.
La deuxième séance plénière a servi à transformer l’accord en plan d’action concret.
L’issue de cette médiation : des accords concrets
À la fin du processus, Élodie et Marc ont signé un avenant au contrat. Ils se sont présentés au salon du e-commerce Paris Retail Week, avec un message fort :
« Ce projet est le fruit de deux expertises complémentaires : la créativité et la technique. »
Bien plus tard, ils m’ont donné des nouvelles et je me suis réjouis d’apprendre qu’ils avaient vécu une super expérience lors de l’édition de ce salon professionnel.
Les enseignements de cette médiation
Que retenir de cette expérience ?
Un contrat n’évite pas les conflits. Une clause floue peut être interprétée différemment selon les parties.
La peur de perdre du temps est un frein classique. Pourtant, la médiation est toujours plus rapide qu’un procès.
Les besoins sont souvent symétriques. Ici, chacun voulait être reconnu : l’un pour ses coûts tangibles, l’autre pour sa valeur intangible.
L’Appreciative Inquiry change la dynamique. En se concentrant sur les forces, on ouvre de nouvelles perspectives.
La transparence renforce la confiance. Un suivi clair des apports évite de futurs malentendus.
Un conflit peut être une opportunité. En le traversant intelligemment, on sort plus fort qu’avant.
Si je devais conclure…
Le conflit entre ces deux entreprises aurait pu mettre fin à un projet prometteur. En choisissant la médiation, ils ont transformé une ambiguïté juridique en levier de coopération.
La leçon est claire : un contrat fixe un cadre, mais c’est la qualité de la relation qui détermine la réussite d’un partenariat. Je ne le dirais jamais assez : parlons-nous, ça nous évitera bien des conflits !
Si vous êtes confronté(e) à un conflit professionnel, ne laissez pas la tension s’installer.
👉 Je vous propose d’en parler ensemble, en toute confidentialité. Prenez rendez-vous.
Cet article est l’épisode #42 de la newsletter “Parlons conflit” diffusée gratuitement par email à ses abonnés tous les dimanches à midi. Chaque semaine, retrouvez Sébastien Robineau pour décrypter un conflit professionnel et découvrir comment en sortir. Pour recevoir le prochain numéro, abonnez-vous ici : abonnement
#conflit #médiation #AppreciativeInquiry #AI