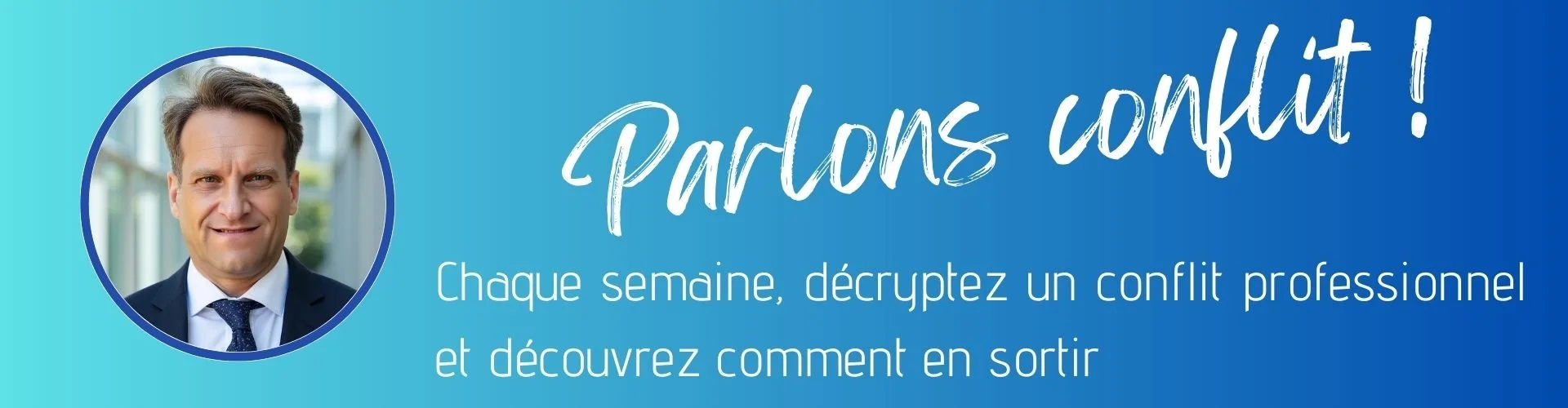Médiation après un simple malentendu devenu un conflit d’équipe
14 septembre 2025 | Écrit par Sébastien Robineau | Temps de lecture : 10 minutes
Sommaire
Un conflit, une médiation
Le frein à la médiation : la méconnaissance du processus
Le déroulement de la médiation : de l’individuel au collectif
L’outil utilisé dans cette médiation : l’analyse transactionnelle
Les enseignement de cette médiation
Conclusion
Un conflit, une médiation
C’est l’histoire d’une start-up qui connaît une croissance d’effectif rapide. Mais le problème aurait pu émerger dans une entreprise d’une toute autre stature ! Basée à Paris, elle a doublé ses effectifs en deux ans. L’énergie est palpable, mais la pression aussi. Dans ce contexte, les tensions entre services ne sont pas rares.
Depuis plusieurs mois déjà, les relations entre Sophie, responsable produits, et Ben, responsable commercial, s’étaient tendues. Les réunions hebdomadaires étaient devenues houleuses. Sophie reprochait à Ben de “surpromettre” aux clients pour décrocher des contrats. Ben accusait Sophie de “brider l’ambition” en freinant les projets.
Ces désaccords restaient jusque-là gérables. Mais des signaux faibles étaient visibles :
Les mails de Ben devenaient plus secs, souvent en copie à plusieurs membres de la direction comme pour se protéger.
Sophie avait cessé d’inviter Ben aux réunions techniques, estimant qu’il “ne comprenait rien”.
Les équipes respectives commençaient à adopter la posture de leur manager, renforçant la fracture entre les pôles.
Puis est apparu l’épisode du calendrier contradictoire : une présentation orale annonçant un lancement en trois mois, et un compte-rendu écrit fixant un délai de six mois.
Le point de tension est apparu lorsqu’un client, démarché par Ben, a demandé une démonstration du produit. Sophie a rétorqué que c’était impossible, les fonctionnalités ne seraient pas prêtes avant l’automne. Et là, le clash en pleine réunion, sous le regard médusé des équipes…
Ben s’est alors senti trahi :
“Comment veux-tu que je garde ma crédibilité auprès de mes clients si tu me contredis ?”
Sophie a explosé à son tour :
“C’est toi qui me mets en difficulté en vendant quelque chose qui n’existe pas encore !”
Devant leurs équipes, la dispute a pris une dimension publique. Les collaborateurs, gênés, ont commencé à murmurer que “la guerre des chefs” risquait de couler le projet.
C’est ce qu’on appelle un conflit lié aux informations disponibles : chacun avait une version différente de la même décision stratégique, et le manque de clarification a transformé une divergence technique en affrontement personnel.
Le frein à la médiation : la méconnaissance du processus
Face à cette impasse, la DRH a proposé une médiation. Sophie a accepté immédiatement. Mais Ben a refusé.
Pourquoi ? Parce qu’il croyait que la médiation était une sorte de procès déguisé.
Il m’a confié lors de notre premier échange :
“Je ne veux pas qu’un inconnu vienne me dire qui a raison ou qui a tort. Je n’ai pas besoin d’un juge.”
Cette méconnaissance du processus est fréquente. Beaucoup confondent médiation, conciliation et arbitrage. Ben craignait :
de perdre la face devant Sophie,
d’être jugé par une autorité extérieure,
de se voir imposer une solution.
En quelques mots, je lui ai expliqué :
que je ne rendrais pas de décision,
que les deux parties restaient libres de tout accord,
qu’elles étaient même libres de mettre fin à la médiation à tout moment,
que mon rôle était de faciliter le dialogue, pas de trancher.
Une fois rassuré sur ces points, Ben a fini par accepter de participer à ce processus, à la plus grande satisfaction de la DRH.
Le déroulement de la médiation : de l’individuel au collectif
Avant toute réunion commune, j’ai mené des entretiens séparés. Ces moments sont cruciaux, car ils permettent de libérer une parole parfois étouffée par la peur du jugement.
Sophie est arrivée tendue, dossiers sous le bras. Très vite, elle a exprimé sa lassitude :
“J’ai l’impression de réparer en permanence les promesses irréalistes de Ben. Mes équipes sont découragées. Quand je dis non, on me prend pour la rabat-joie.”
En creusant, un besoin fort a émergé, celui de la reconnaissance de sa compétence technique. Ce qu’elle redoutait par-dessus tout, c’était de passer pour une obstacle au développement, alors qu’elle cherchait seulement à garantir la qualité.
Le discours de Ben était tout autre :
“Je ne fais que relayer ce qu’on m’a dit en réunion. Si Sophie ralentit tout, ce n’est pas ma faute. Et maintenant, je passe pour un menteur auprès de mes clients.”
Derrière cette colère, j’ai entendu un besoin de sécurité et de fiabilité de l’information. Ben se sentait piégé. Il se disait coincé entre une direction trop vague et une équipe produit qui, selon lui, “ne jouait pas collectif”.
J’ai également échangé avec la DRH. Sa vision du conflit pouvait m’apporter un éclairage. Le fameux “arbre qui cache la forêt” ! Elle a reconnu que le style « informel » du CEO avait pu semer la confusion. Il s’emballe souvent quand il prend la parole, il est dans une dynamique qui est devenue l’ADN de la boîte. Mais quand il s’agit d’écrire ce qu’il a dit, il se rend compte qu’il a poussé le bouchon un peu trop loin… Alors il corrige le tir, au risque de créer une cacophonie….
Ces entretiens ont mis en lumière que le conflit n’était pas dû à la mauvaise volonté d’un individu, mais à un système de communication défaillant.
Lors de la première réunion commune, les visages étaient fermés. Ben et Sophie évitaient le regard de l’autre.
Je leur ai proposé un exercice simple : chacun expose sa version des faits, l’autre écoute sans interrompre, puis reformule ce qu’il a entendu.
Sophie a dit :
“Quand tu annonces aux clients des délais irréalistes, je me sens discréditée.”
Ben a reformulé :
“Tu as l’impression que je te mets en difficulté devant tes équipes.”
Puis Ben a expliqué à son tour :
“Quand tu contestes mes propos devant les clients, je me sens trahi.”
Sophie a reformulé :
“Tu as besoin que je soutienne ton discours commercial.”
Ce jeu de miroir a permis une prise de conscience mutuelle : chacun n’agissait pas contre l’autre, mais en réaction à une information contradictoire.
L’outil utilisé dans cette médiation : l’analyse transactionnelle
Pour aller plus loin, j’ai introduit l’analyse transactionnelle (AT).
Nous avons revisité leurs échanges sous l’angle des “états du moi”. En AT, nous reconnaissons que le psyché d’un individu a trois composantes (qu’on appelle les “états du moi”) : l’état Parent, l’état Adulte et l’état Enfant. Et quand nous parlons à une personne, inconsciemment (le plus souvent…), nous nous exprimons depuis l’un de nos trois états du moi. pour illustrer, voilà ce que ça peut donner entre Sophie et Ben :
Ben, Parent critique : “Tu n’es jamais prête dans les temps.”
Sophie, Enfant rebelle : “Tu ne comprends rien à la technique !”
Ces transactions croisées alimentaient le conflit.
Je leur ai montré comment passer à des échanges Adulte – Adulte :
Ben : “J’ai besoin de dates précises pour mes clients. Quelle est ta meilleure estimation réaliste ?”
Sophie : “Voilà le planning actuel. Si tu veux accélérer, il faudrait plus de développeurs. Souhaites-tu que nous en parlions au CEO ?”
En s’exerçant à ce type de dialogue, ils ont découvert qu’ils pouvaient défendre leurs besoins sans s’attaquer mutuellement.
L’issue de cette médiation : des accords concrets
À la fin de la médiation, Sophie et Ben ont élaboré plusieurs règles simples :
Un canal unique de communication : chaque décision stratégique doit être envoyée simultanément par écrit aux deux responsables.
Un rendez-vous hebdomadaire de 30 minutes entre “équipe produits” et “équipe commerciale” pour aligner leurs messages.
Un droit d’alerte : si l’un constate une incohérence, il doit en parler immédiatement à l’autre avant toute communication externe.
Un soutien public mutuel : jamais de contradiction devant les clients ou les équipes. Les désaccords doivent être réglés en privé.
Ces accords ont été formalisés par écrit, signés symboliquement par les deux responsables.
Les enseignements de cette médiation
Que retenir de cette expérience ?
Les conflits naissent souvent d’informations contradictoires. Avant d’accuser l’autre de mauvaise foi, vérifiez la clarté des messages.
La médiation n’est pas un jugement. Elle n’impose rien. Elle ouvre un espace où chacun peut être entendu.
Nos postures alimentent le conflit. Un “Parent critique” suscite un “Enfant rebelle”. Pour avancer, il faut activer l’”Adulte”.
Les solutions sont souvent simples. Un canal unique d’information, un rituel de coordination, un droit d’alerte : trois leviers qui évitent des mois de tension.
Le rôle du médiateur est de rétablir la confiance. Il ne règle pas le problème à la place des parties : il leur permet de retrouver leur capacité à coopérer.
Si je devais conclure…
Le conflit entre Sophie et Ben n’était pas une question de personnalité, mais un problème de communication. Leur médiation a montré qu’une divergence sur une date pouvait cristalliser des blessures profondes si elle n’était pas traitée.
Grâce à l’analyse transactionnelle, ils ont compris leurs mécanismes de défense. Grâce à la médiation, ils ont transformé un affrontement en collaboration renforcée.
La leçon est simple : mieux vaut investir du temps à clarifier l’information que du temps à réparer les dégâts d’un malentendu.
Si vous êtes confronté(e) à un conflit professionnel, ne laissez pas la tension s’installer.
👉 Je vous propose d’en parler ensemble, en toute confidentialité. Prenez rendez-vous.
Cet article est l’épisode #39 de la newsletter “Parlons conflit” diffusée gratuitement par email à ses abonnés tous les dimanches à midi. Chaque semaine, retrouvez Sébastien Robineau pour décrypter un conflit professionnel et découvrir comment en sortir. Pour recevoir le prochain numéro, abonnez-vous ici : abonnement
#conflit #médiation #cnv