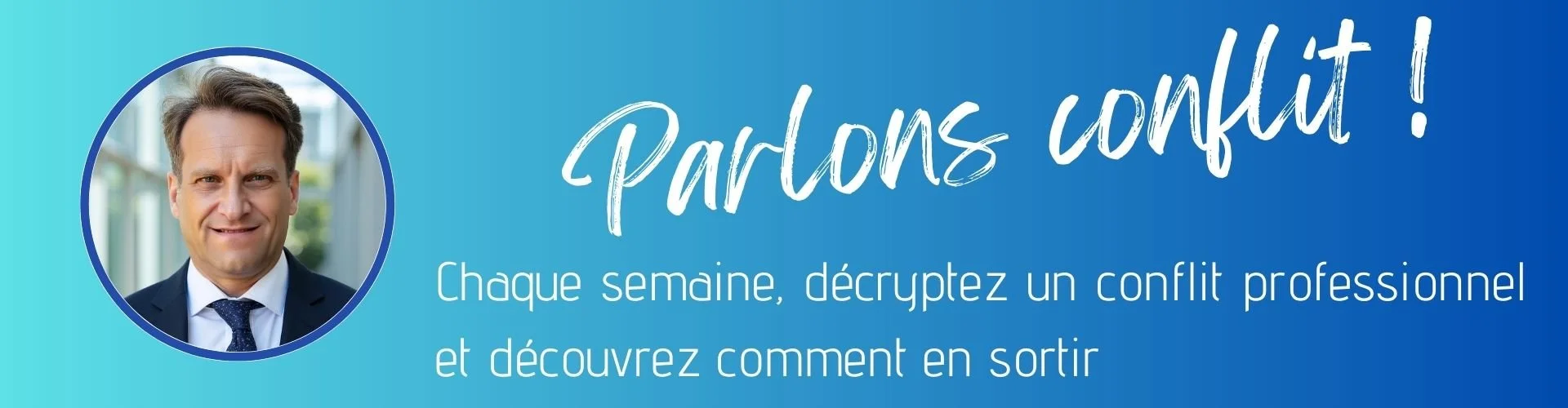Médiation entre associés d’une PME nantaise
7 septembre 2025 | Écrit par Sébastien Robineau | Temps de lecture : 10 minutes
Sommaire
Un conflit, une médiation
Le frein à la médiation : la peur de perdre la face
Le déroulement de la médiation : de l’individuel au collectif
L’outil utilisé dans cette médiation : la communication non violente
Les enseignement de cette médiation
Conclusion
Un conflit, une médiation
Ils étaient trois associés dans une PME de services numériques basée à Nantes. Leur aventure avait commencé dix ans plus tôt, dans l’enthousiasme et la complémentarité des talents. Paul, l’ingénieur brillant, passionné par la technique. Marc, l’homme du développement commercial, charismatique et persuasif. Julien, le gestionnaire rigoureux, garant de l’équilibre financier.
Pendant plusieurs années, leur complémentarité a fait la force de l’entreprise. Mais derrière la réussite, des tensions silencieuses se sont accumulées. Paul reprochait à Marc de promettre trop aux clients sans mesurer les capacités réelles de production. Marc trouvait Paul rigide et incapable de voir plus loin que ses lignes de code. Julien, lui, s’efforçait de maintenir l’équilibre, mais voyait bien que la relation entre ses deux associés se dégradait.
Le point de rupture a eu lieu lors d’une réunion de direction. Ce jour-là, devant l’équipe, Paul a reproché à Marc de “saboter le projet” en refusant d’allouer des ressources supplémentaires à une mission stratégique. Marc a répliqué en l’accusant de “dramatiser pour cacher ses erreurs”. L’échange a dégénéré en attaque personnelle. Devant les salariés médusés, les deux associés ont exposé au grand jour un conflit qui couvait depuis longtemps.
À partir de là, les échanges directs ont cessé. Paul et Marc ne s’adressaient plus la parole, se contentant de passer par Julien pour transmettre leurs messages. Les réunions devenaient glaciales, les décisions se prenaient au ralenti, et la confiance mutuelle, ciment de leur association, semblait définitivement brisée.
L’origine du conflit ? Une atteinte à la personne et à la relation. Les désaccords techniques ou commerciaux avaient laissé place à des blessures profondes liées au respect et à la reconnaissance.
Le frein à la médiation : la peur de perdre la face
Face à cette impasse, Julien a proposé de recourir à un médiateur. Sa suggestion semblait de bon sens : l’entreprise avait besoin de retrouver de la fluidité relationnelle pour continuer à avancer. Mais Marc s’y est fermement opposé.
Pourquoi ? Parce qu’il craignait de perdre la face.
Dans son esprit, accepter une médiation revenait à reconnaître qu’il avait eu tort. Lui, le commercial, l’homme de l’image, ne voulait pas apparaître comme celui qui cède. Il redoutait que ses équipes interprètent cette démarche comme un signe de faiblesse.
Cette peur est fréquente. De nombreuses personnes confondent médiation et compromis forcé. Elles imaginent que le médiateur va les pousser à “capituler” ou à “faire amende honorable” devant l’autre. C’est mal me connaître et c’est ignorer le processus de la médiation. En réalité, la médiation n’impose aucune solution. Elle crée un espace sécurisé où chacun garde la maîtrise de ce qu’il dit et accepte.
Mais pour Marc, prisonnier de sa représentation, l’idée même de s’asseoir en médiation équivalait à une humiliation. Ce frein a retardé de plusieurs semaines le démarrage du processus, aggravant encore la tension et l’isolement entre associés.
Le déroulement de la médiation : de l’individuel au collectif
Lorsque Marc a finalement accepté un premier rendez-vous (à condition qu’il soit individuel…), le travail de médiation a pu commencer.
Dans nos échanges séparés, j’ai découvert des réalités très différentes :
Paul se sentait trahi. Selon lui, Marc avait miné sa crédibilité devant l’équipe. Il n’acceptait pas d’être présenté comme un technicien incapable de gérer un projet.
Marc, de son côté, se disait victime d’un dénigrement permanent. Il avait l’impression que Paul cherchait à le discréditer auprès des salariés, en le présentant comme superficiel et uniquement intéressé par les chiffres.
Julien, enfin, se sentait pris au piège. Fatigué d’endosser le rôle de tampon, il redoutait que l’entreprise s’effondre si ses associés ne parvenaient pas à se réconcilier.
Ces entretiens ont permis à chacun de déposer ses émotions sans crainte d’être jugé. Pour Marc, c’était essentiel : pouvoir dire sa peur de “perdre son statut” sans que Paul soit présent a ouvert une brèche. C’est là qu’il a commencé à envisager qu’un espace de médiation puisse être une opportunité, non une menace.
Une fois la confiance installée, j’ai réuni les trois associés pour une première séance plénière. Le cadre était clair : confidentialité totale, respect mutuel, et liberté pour chacun de s’exprimer sans être interrompu.
Au début, les tensions étaient palpables. Les regards fuyants, les bras croisés, les silences lourds. Mais peu à peu, grâce au processus structuré, chacun a pu exprimer son vécu.
Paul a lâché un truc du genre :
“Quand tu as affirmé devant toute l’équipe que je sabotais le projet, je me suis senti humilié. J’ai eu l’impression que tu détruisais la confiance que mes collaborateurs avaient en moi.”
Marc lui a rétorqué du tac au tac :
“De mon côté, j’ai entendu tes critiques comme une attaque personnelle. J’ai eu le sentiment que tu voulais me faire passer pour un incompétent. Devant l’équipe, j’ai ressenti de la colère et de la peur : peur de perdre ma place, peur d’être affaibli.”
Julien, quant à lui, a exprimé son épuisement :
“Vous ne vous rendez pas compte à quel point je souffre de votre conflit. Je passe mon temps à jouer les messagers. Je veux que nous retrouvions un climat où nous pouvons décider ensemble, sans nous déchirer.”
Le simple fait d’entendre ces paroles sans interruption a déjà amorcé un désamorçage. Pour la première fois depuis des mois, les associés se sont écoutés vraiment.
L’outil utilisé dans cette médiation : la communication non violente
Pour transformer ces échanges en pistes de solution, j’ai proposé de travailler avec la communication non violente (CNV).
Cet outil repose sur quatre étapes simples :
Observer sans juger : décrire les faits de manière neutre.
Exprimer son ressenti : dire ce que l’on a éprouvé.
Identifier son besoin : clarifier ce qui est important pour soi.
Formuler une demande claire : proposer une action concrète et réaliste.
Concrètement, cela a donné les reformulations suivantes :
“Quand tu refuses de valider les budgets sans discussion, je me sens découragé. J’ai besoin que mon travail technique soit reconnu. J’aimerais que nous puissions examiner ensemble les priorités avant de communiquer à l’équipe.” - Paul
“Quand j’entends que je vends du rêve, je me sens rabaissé. J’ai besoin de confiance dans ma capacité à développer nos clients. J’aimerais que nous en parlions directement si l’un d’entre nous a un doute, plutôt que de le dire devant l’équipe.” - Marc
Petit à petit, grâce à ces formulations, le ton a changé. Les reproches ont laissé place à des demandes concrètes. Les besoins de chacun (respect, reconnaissance, sécurité) sont apparus comme légitimes.
L’issue de cette médiation : une relation apaisée et clarifiée
À l’issue de deux séances plénières, les associés ont défini ensemble plusieurs engagements :
Communiquer leurs désaccords en privé avant toute réunion collective.
Mettre en place un rituel mensuel de coordination, où chacun exprime ses priorités et contraintes.
Reconnaître publiquement les réussites de l’autre : Paul pour la solidité technique, Marc pour la conquête commerciale.
Partager certaines décisions financières à trois pour éviter de mettre Julien en position de tampon permanent.
Ces accords n’étaient pas des compromis de façade, mais des engagements concrets, nés de leurs propres mots et besoins.
Les enseignements de cette médiation
Que retenir de cette histoire ? Beaucoup de choses.
Un conflit n’est pas seulement un désaccord objectif. Bien souvent, il naît d’une blessure relationnelle : une parole maladroite, une critique ressentie comme une attaque, un manque de reconnaissance.
La peur de perdre la face est un frein puissant. Elle empêche de demander de l’aide, car on craint d’apparaître faible. Pourtant, accepter une médiation est un signe de courage. C’est prendre la responsabilité de chercher une solution.
La communication non violente est un outil universel. Décrire un fait, exprimer un ressenti, identifier un besoin, formuler une demande : quatre étapes simples, applicables dans un bureau, en famille ou même entre voisins.
Le rôle du médiateur est d’offrir un cadre sécurisé. Sans parti pris, sans jugement, il permet à chacun de dire ce qu’il a sur le cœur et de transformer un reproche en demande constructive.
En clair, sortir d’un conflit ne signifie pas perdre. Cela signifie retrouver le pouvoir de coopérer.
Si je devais conclure…
Dans cette histoire, Marc avait peur de perdre la face. Finalement, il a découvert que reconnaître ses blessures, ce n’était pas s’humilier mais se relever.
La médiation lui a permis de se réapproprier sa voix, sans avoir à “capituler”.
Le plus beau ? Ses associés et lui ont compris qu’un conflit bien géré ne détruit pas une relation, il peut au contraire la renforcer.
En médiation, il n’y a ni vainqueur ni vaincu.
Il y a des personnes qui choisissent de transformer leurs tensions en dialogue, et leur dialogue en avenir partagé.
Si vous êtes confronté(e) à un conflit professionnel, ne laissez pas la tension s’installer.
👉 Je vous propose d’en parler ensemble, en toute confidentialité. Prenez rendez-vous.
Cet article est l’épisode #38 de la newsletter “Parlons conflit” diffusée gratuitement par email à ses abonnés tous les dimanches à midi. Chaque semaine, retrouvez Sébastien Robineau pour décrypter un conflit professionnel et découvrir comment en sortir. Pour recevoir le prochain numéro, abonnez-vous ici : abonnement
#conflit #médiation #cnv